My single line text
My single line text
My single line text
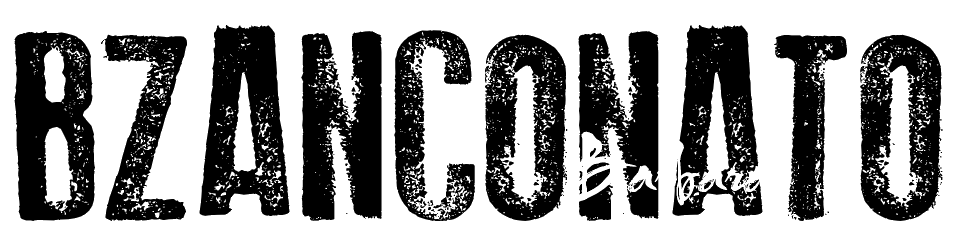
TESHUVA'
6^ Salon International d'Art Contemporain ART3F de Mulhouse
Mulhouse 10-12 novembre 2017

Andrea Fallini
"Teshuvà" (תשובה) est un terme hébraïque qui est souvent traduit comme “repentir” mais qui, en réalité, signifie littéralement “retour”. Et c'est, bien sûr, dans ce sens que B.Zanconato l’a choisi comme titre pour son exposition au Salon de Mulhouse. Cette fois aussi, l’artiste a profité de sa présence non seulement pour présenter ses œuvres mais, surtout, pour proposer au public un parcours émotif et une série de réflexions.
"Teshuvà" (תשובה), pour B.Zanconato, est le symbole du retour que l’homme accomplit vers ce qui, en réalité, est sa vraie essence, du parcours de récupération (et c’est ça le retour) vers sa vraie nature humaine. Cette interprétation comprend aussi la signification courante de repentir parce que ce processus de changement, de reconquête de soi-même implique, concrètement, de reconnaitre les comportements considérés comme négatifs, ou pour le moins non adaptés, et, en conséquence, l’intention de ne plus répéter la même erreur ou la même attitude. Le fait est significatif que, même dans la tradition hébraïque, le concept de Teshuvà soit fondé sur la conviction fondamentale que l’homme est en possession du libre arbitre, c’est-à-dire de la capacité de choix et de la volonté de la mettre en place et que ni l’héritage du passé, ni les conditions environnementales, ni les empêchements matériaux, ne sont suffisants pour bloquer le potentiel humain de changement et d’amélioration.
Avec ce préambule à l'ésprit et en face de l’œuvre centrale de l’expo (“Wall of Dolls”) le spectateur peut se révéler désorienté. L’œuvre, en effet, que l’artiste définit « devanture », s’inspire du sujet de la violence sur les femmes et présente le slogan qui est toujours prononcé dans les débats, dans les discussions publiques et des medias : "Education is the key" (l’éducation est la clé).
Dans l’œuvre de B.Zanconato, en réalité, le slogan est posé en forme d’interrogation (Is education the key – c’est-à-dire est-ce que l’éducation est la clé ?) et il constitue une sorte de barrière, de mur (wall) sur lequel émergent de candides figures ailées (dolls), placées la tête en bas, symboles des victimes des violences. Mais l’éducation est-elle vraiment la clé de tout ? et quelle éducation ?
Devant les violences continues mentionnées par les informations, avec l’œuvre "Wall of Dolls", l’artiste cherche de porter l’attention sur l’hypocrisie de la catharsis collective à laquelle, tous les jours, nous sommes témoins. Manifestations, prises de positions, initiatives politiques répètent le cliché stérile résumé du slogan "Education is the key" et chaque fois de nouvelles initiatives sont lancées dans les écoles (qui dans la vision courante sont les seules sièges autorisés à offrir la bonne éducation) sans, par ailleurs, aborder la question dans sa plus grande complexité.
Sensibiliser au respect les nouvelles générations est certainement une chose utile, mais la question de fond qui se pose, et qui n’émerge jamais à l'occasion des violences quotidiennes vis-à-vis des femmes, est l’absence d’une analyse profonde de la situation des rapports de genre et le manque complet d’une nouvelle vision cohérente avec le message qui est lancé. En effet, comment peut être efficace une campagne de sensibilisation visant à éliminer les discriminations homme-femme si après, dans la pratique, les différences de genre restent à la base des attitudes quotidiennes
Sensibiliser au respect les nouvelles générations est certainement une chose utile, mais la question de fond qui se pose, et qui n’émerge jamais à l'occasion des violences quotidiennes vis-à-vis des femmes, est l’absence d’une analyse profonde de la situation des rapports de genre et le manque complet d’une nouvelle vision cohérente avec le message qui est lancé. En effet, comment peut être efficace une campagne de sensibilisation visant à éliminer les discriminations homme-femme si après, dans la pratique, les différences de genre restent à la base des attitudes quotidiennes

(qui donnent l’exemple au plus jeunes), des modèles sociaux et de la conception des rapports de genre à tous les niveaux? Est-il suffisant de diaboliser les comportements extrêmes, qui portent aux féminicides, quand après, on peut lire dans les statistiques les plus récentes, une femme sur trois a subi et continue à subir des actes de violence? Ou, peut-être, qu'aborder la question de façon complète, directe, pratique, en mettant en discussion même la diversité de genre comme élément d’identification, serait trop révolutionnaire et déstabilisant?
Ce camouflage de la question clé est à la base de la façon expressive employé par l’artiste: d’abord, comme déjà dit, le slogan a été présenté sous la forme de question (où l’artiste a omis le point d’interrogation), mais, surtout, la représentation est caractérisée par de forts éléments graphiques, typiques de la publicité et du marketing. Avec cette œuvre B.Zanconato semble nous dire que cette façon de faire n’est que de la pub, c’est une façade, une sorte de « devanture » (un peu comme les devantures des boutiques) parce que rien ne changera tant que nous considérerons les gens en fonctions de leur genre, tant que nous les éduquerons et les pousserons vers des attitudes différentes selon leur sexe d’appartenance. Et, à bien y regarder, les dolls que B.Zanconato a intégrées dans son oeuvre sont dépourvues de références sexuelles, pour souligner que les victimes de l’actuelle « éducation » et mentalité ne sont pas, en réalité, seulement les femmes mais aussi les hommes, même eux sont les victimes d’un climat culturel qui les a grandis en leur inculquant le concept de la dominance de genre: un homme est tel seulement s’il domine et on ne peut lui reconnaître aucune fragilité.
Ce camouflage de la question clé est à la base de la façon expressive employé par l’artiste: d’abord, comme déjà dit, le slogan a été présenté sous la forme de question (où l’artiste a omis le point d’interrogation), mais, surtout, la représentation est caractérisée par de forts éléments graphiques, typiques de la publicité et du marketing. Avec cette œuvre B.Zanconato semble nous dire que cette façon de faire n’est que de la pub, c’est une façade, une sorte de « devanture » (un peu comme les devantures des boutiques) parce que rien ne changera tant que nous considérerons les gens en fonctions de leur genre, tant que nous les éduquerons et les pousserons vers des attitudes différentes selon leur sexe d’appartenance. Et, à bien y regarder, les dolls que B.Zanconato a intégrées dans son oeuvre sont dépourvues de références sexuelles, pour souligner que les victimes de l’actuelle « éducation » et mentalité ne sont pas, en réalité, seulement les femmes mais aussi les hommes, même eux sont les victimes d’un climat culturel qui les a grandis en leur inculquant le concept de la dominance de genre: un homme est tel seulement s’il domine et on ne peut lui reconnaître aucune fragilité.
Le sujet de la prévarication introduit par « Wall of Dolls » est mis encore plus en évidence par une autre œuvre en expo à Mulhouse : « The child bride ». Ici le thème est celui des «enfants épouses» qui, inconscientes de ce qui les attend et pleines d’illusions pour l’atmosphère de fête et pour la robe de mariage, sont vendues en épouses à des hommes adultes selon une cruelle tradition de mariage qui les considère comme des marchandises vivantes à troquer dans le cadre d’un accord économique et de complaisance entre les familles. Apparemment le sujet touche des coutumes et des habitudes sociales qui nous apparaissent lointaines: en réalité différents cas d’enfants épouses ont été dénoncés dans nos sociétés (même si dans le cadre de familles originaires de zones géographiques dans lesquelles cette pratique est encore à l’ordre du jour) et, en plus, il y a quelques générations d'ici, même en Italie (si non en Europe), beaucoup de filles étaient obligées par la famille de se marier, pour des raisons différentes, avec des hommes qu’elles n’avaient pas choisi, sans parler du fait qu’elles n’avaient pas le droit de décider la direction de leur vie et la profession qu’elles auraient voulu faire.

Mais le sujet ici n’est pas seulement celui de la violence deux fois subie par ces enfants (de la part du mari qui les achemine, pas encore prêtes et conscientes, à la vie adulte, et de la part de la famille ou du père de famille qui, plus comme un maître que comme un père, il en fait matière de commerce) mais aussi et surtout c'est celui de l’atavique et non encore dépassé droit de suprématie masculine, centré sur la force et la violence, qui encage encore le destin de beaucoup de femmes (et, en même temps, de beaucoup d'hommes aussi) qui ont subi et subissent dès l’enfance cette sorte d’endoctrinement. C’est clair que les conséquences de ce type de vision et d’« éducation » sont flagrantes sinon limites, dans les cas des enfants épouses, mais il faut dire que, sournoisement, elles sont encore insinuées dans la mentalité et dans la vie quotidienne de beaucoup d’entre nous: pour pas mal de causes, toutes de facilité, elle restent tacitement latentes… jusqu’à ce qu'elles, pour les raisons les plus diverses, remontent de façons extrêmes, toujours violentes.
Cet élément de camouflage, c’est-à-dire de présence d’une sorte de double morale qui amène à condamner publiquement les conséquences extrêmes de certains aspects qui, en réalité, sont implicites dans la mentalité encore courante, et qui est au centre des premières œuvres exposées, ressort de façon puissante même dans une autre œuvre de B.Zanconato, dans une autre devanture exposée à Mulhouse : « G.R. ».
Cet élément de camouflage, c’est-à-dire de présence d’une sorte de double morale qui amène à condamner publiquement les conséquences extrêmes de certains aspects qui, en réalité, sont implicites dans la mentalité encore courante, et qui est au centre des premières œuvres exposées, ressort de façon puissante même dans une autre œuvre de B.Zanconato, dans une autre devanture exposée à Mulhouse : « G.R. ».
« G.R. » représente d’une côté une réflexion sur la vérité (celle des media, avant tout, liée à des raisons compréhensibles d’audience, vu le business de l’information, mais aussi celle de l’opinion publique qui semble s’appuyer directement sur celle des medias, et qui, au fil du temps, subit un inexorable processus de dégradation), de l’autre une réflexion sur la superficialité émotive collective face aux faits de violence et sur ses raisons. Le cas de Giulio Regeni (dont les initiales donnent le titre à cette œuvre) est un autre, emblématique exemple: immédiatement après la tragique disparition du jeune chercheur italien en Égypte, les réseaux sociaux du monde entier et les places de beaucoup de villes italiennes ont été tapissées d’affiches et de banderoles jaunes vantant la «vérité». Mais avec le recul du temps, tout ça, pour ainsi dire, s’est « oxydé ».
Et c’est cette attitude de facile oxydation émotive
Et c’est cette attitude de facile oxydation émotive

que l’artiste veut mettre en évidence avec cette oeuvre: toute l’empathie initiale s’est consumée rapidement et elle s’est épuisée avec la présentation de quelques banderoles (surtout au niveau politique) ou avec la publication du panneau jaune ou avoir donné un like sur les réseaux sociaux ou sur une page internet. De la même façon, cela s’est passé pour d’autres épisodes qui ont eu lieu en Europe dans les dernières années, où ce besoin de prise de position, pour de nombreux, a abouti et a trouvé sa catharsis avec de faciles manifestations symboliques, souvent faites par les réseaux sociaux (normalement une image sur sa propre page internet). Et ça c'est le point intéressant: la participation, c’est-à-dire le fait d’y être mais comme une partie d’un groupe, même si pour un bref moment, devient l’élément essentiel peut-être encore plus fort du fait de manifester sa propre pensée vis-à-vis de ces faits de violence.
Et la relation avec le groupe est au centre de « Io voglio TU DEVI » (Moi, je veux TOI, TU DOIS). « Io voglio TU DEVI » résume, avec une lapidaire synthèse graphique, le conflit de l’individu plongé dans la société contemporaine. En effet, d’un côté, il y a l’individu et sa faible volonté, symbolisés par l’écriture italique Io voglio (Moi, je veux), reliée dans un coin sombre, opprimée si non menacée par un grand impératif : TU DEVI, toi, tu dois. TU DEVI (Toi, tu dois) est l’expression des différents côtés de la vie contemporaine qui soumettent l’individu à une infinie série de pressions avec le but d’en conditionner le comportement. Et tout ça joue sur le besoin d’appartenance. L’appartenance à la famille a toujours comporté des règles qui ont imposé certains comportements (les femmes le savent depuis longtemps). Mais la société contemporaine a étendu ce concept: faire partie du groupe signifie disposer des derniers appareils technologiques, parce que, autrement, l’on est «off»; faire partie du groupe signifie être toujours en forme; appartenir au groupe signifie s’habiller avec un des uniformes à la mode; appartenir au groupe signifie avoir toujours un aspect jeune et charmant, comme en témoignent les modèles publicitaires qui nous bombardent tous les jours et qui nous montrent quelle est la « bonne » route pour le bonheur. Il s’agit de suivre les règles et les traditions, il s’agit d’écouter ce que nous suggèrent les spécialistes du secteur; de suivre les trends du moment, de poursuivre le succès qui porte à plus de possibilités économiques pour augmenter l’accumulation d’objets toujours nouveaux, à la recherche de cet assouvissement et de cette félicité qui semblent dépendre de la nouvelle recette qui chaque jour nous est proposée et qui, comme par hasard,

devrait valoir pour tout le monde mais ne vaut pour personne. Mais hélas, dommage que les modes changent (c’est le concept même de mode qui le certifie), que les derniers outils technologiques deviennent obsolètes très rapidement et que les modèles de référence sont inaccessibles: en pratique, si d’un côté la félicité comme assouvissement est à portée de la main, en réalité elle n’arrive jamais ou elle n’est pas destinée à durer. Et ça, dans le temps, nous déstabilise, augmente le sentiment d’inadéquation et de méfiance en nous-mêmes et ça va donner, comme conséquence, un sentiment de solitude, cette solitude que la société diabolise comme le pire des maux mais qui, peut-être, à bien y regarder, n’est pas si négative.
La solitude est le sujet de « Before ». « Before » nous présente une partie d’un visage de femme comme vue par le judas d’une cellule ou par une petite fenêtre. Et la surface en bois qui entoure le visage souligne la séparation, exalte la présence d’un mur qui s’élève entre le spectateur et la figure féminine qui est représentée comme prise pendant une de ses réflexions, à l’intérieur de son monde. Symbole de la solitude à l’intérieur des murs domestiques? Peut-être. Ou, au contraire, symbole de cette solitude qui aide et qui sert pour aller dedans soi-même, de la concentration et du silence nécessaires à cueillir sa propre voix profonde, à la recherche de nos vrais valeurs et des choses dans lesquelles nous croyons vraiment. Ou encore symbole de cette solitude de laquelle souvent nous avons peur et à cause de laquelle nous acceptons de fausses amitiés, nous acceptons d’être à des manifestations dont nous échappe le sens et de partager nos moments privés avec de parfaits inconnus, qui nous fait dire très rarement ce que nous pensons. P. Mercier dans son “Train de nuit pour Lisbonne” décrit très bien cet état de choses: « la solitude que nous craignons : en quoi consiste-t-elle en fin de compte? Dans le silence de protestations tues? Dans le fait de ne pas avancer avec prudence, en retenant son souffle, sur le champ de mines des mensonges conjugales et des vérités entre amis ? Dans la liberté de n’avoir personne en face pour le déjeuner? Dans l’abondance de temps qui se dévoile quand l’on fait taire le tambour battant des rendez-vous? Ne sont-ce pas toutes des choses merveilleuses? Un état paradisiaque? En quoi consiste alors la peur ? Est-ce qu’il ne s’agit pas, en fin de compte, d’une crainte qui subsiste par le seul fait que nous n’ayons examiné jusqu’au bout son objet ? Une crainte qui nous a été inculquée par des discours inconsidérés de parents, professeurs, prêtres? Et pourquoi sommes-nous si sûrs que les autres ne nous envieraient pas s’ils voyaient combien notre liberté est augmentée ? Et qu'ils ne chercheraient pas notre compagnie exactement pour ça ? »

En réponse à ces intrigantes questions arrivent deux autres œuvres : « Skeleton » et « MAKES a DIFFERENCE ». La première (« Skeleton », c’est-à-dire squelette), reprend de façon plus directe le sujet de l’introspection, d’aller fouiller dans le fond de notre essence humaine pour en voir les éléments constitutifs et fondamentaux. Le symbole du squelette, de ce point de vue, est très puissant : le squelette en effet est l’élément du corps qui soutient le soi et l'ensemble des organes et systèmes. En plus c’est la partie du corps qui résiste le plus au temps. Et donc, quelle est la partie de nos comportements vraiment liée à notre essence d’individus uniques et non-reproductibles et quelle est, au contraire, la partie déterminée de superstructures que l’on nous a fait porter et qui se sont décantées et durcies dans le temps ? À cet égard l’artiste semble reprendre le mythe grecque de Er, pour lequel, avant la naissance, chaque âme choisit un destin, un paradigme qui en influencera le comportement de vie et que, après, il aura la possibilité de mener à terme. Mais une fois confirmé et rendu inéluctable le choix fait par l’âme de la part des Moires, l’âme reçoit en assignement aussi un démon des tutelles. Avant de descendre sur la terre, les âmes s’arrêtent dans la plaine du fleuve Léthé et sont obligées à en boire l’eau: les eaux du Léthé donnent l’oubli. Ceux d'entre eux qui n’arrivent pas à se retenir, en boivent beaucoup et ils seront ceux qui se rappelleront le moins de leur choix. Le génie des tutelles, toutefois, ne boit pas d’eau et quand il tombe sur la terre avec l’âme, il reste conscient du destin auquel il est resté enchaîné: son devoir est de conduire l’âme vers l’achèvement de son destin.

« Skeleton » pour B.Zanconato est le symbole de notre essence, c’est à dire du paradigme que notre âme a choisi et dont l’achèvement représente la raison pour laquelle nous sommes au monde. D'un autre côté, dans le temps ce paradigme, viens recouvert de couches et couches de superstructures qui nous sont imposées, dès le plus jeune âge, par l’éducation et qui, petit à petit, vient substitué par des projections qui nous empêchent même d’entendre les suggestions que le génie des tutelles donne à chacun sous la forme d’intuitions, de rêves, de passions.
Voilà pourquoi le processus d’introspection et d’identification de l’essence humaine de chacun est strictement lié à la solitude : il faut, en effet, prendre une certaine distance des choses, des gens, des situations pour avoir les idées claires sur ce qui nous appartient et ce dont, au contraire, nous pouvons ou nous devons nous libérer ou, en d’autres termes, pour mieux entendre la voix de notre guide intérieur. Et, en même temps, ce dialogue intérieur donne origine à la pensée (à notre pensée) et à la définition de nos valeurs.
C'est seulement comme cela que nous apprendrons à nous re-connaître nous-mêmes: en nous rappelant notre essence et en identifiant nos aspirations plus profondes. Seulement à ce moment nous prendrons possession de notre vie à la place de poursuivre un mythe générique de félicité qui nous vient propagé comme inclus dans les biens que nous trouvons dans les commerces mais qui après, l’achat fait, se révèlent décevants.
Par contre, réaliser notre potentiel, développer nos talents : c’est ça qui fait la différence (« MAKES a DIFFERENCE »): faire les choses parce que en nous il y a une force qu’on ne peut pas arrêter et qui nous pousse à les faire; suivre une direction dans notre vie parce que nous ressentons que, malgré tout, celle-là c’est la nôtre. Croire profondément à certains principes et valeurs parce que nous les ressentons comme nôtres et les vivons à la première personne. Croire dans notre unicité et non répétabilité; croire en nous et dans nos capacités de jugement. Croire que nous avons un potentiel à développer: ça fait une grande différence!
C'est seulement comme cela que nous apprendrons à nous re-connaître nous-mêmes: en nous rappelant notre essence et en identifiant nos aspirations plus profondes. Seulement à ce moment nous prendrons possession de notre vie à la place de poursuivre un mythe générique de félicité qui nous vient propagé comme inclus dans les biens que nous trouvons dans les commerces mais qui après, l’achat fait, se révèlent décevants.
Par contre, réaliser notre potentiel, développer nos talents : c’est ça qui fait la différence (« MAKES a DIFFERENCE »): faire les choses parce que en nous il y a une force qu’on ne peut pas arrêter et qui nous pousse à les faire; suivre une direction dans notre vie parce que nous ressentons que, malgré tout, celle-là c’est la nôtre. Croire profondément à certains principes et valeurs parce que nous les ressentons comme nôtres et les vivons à la première personne. Croire dans notre unicité et non répétabilité; croire en nous et dans nos capacités de jugement. Croire que nous avons un potentiel à développer: ça fait une grande différence!

"Teshuvà" (תשובה), l’oeuvre qui donne le titre à l’expo est la synthèse de tous ces thèmes. L’invitation que l’artiste semble lancer est de prendre ses distances par rapport aux attitudes et aux manifestations de façade, de ne pas avoir peur à rester en dehors du groupe, du choeur de toutes ses voix identiques, mais au contraire d’ établir un dialogue profond avec nous-mêmes et récupérer notre vraie essence. Teshuvà, donc, dans le sens étymologique: revenons à nous-mêmes, à nos vrais besoins et aspirations, à notre essence qui n’a pas besoin d’uniformes pour se protéger, qui n’a pas besoin d’un genre pour s’identifier. Comme la mince figure humaine profilée dans l’œuvre: homme ou femme peu importe. Ce qui importe est le chemin, la progression, le faire, la création, sans avoir de superstructures qui empêchent (comme le drapeau rouge qui est en train de s’envoler), sans avoir de chaines qui nous bloquent (comme celles qui pendent des côtés). Teshuvà, avec la confiance que cette possibilité est dans nos mains et que ni l’héritage du passé, ni les conditions pratiques d’aujourd’hui ne peuvent arrêter nos possibilités de changement et d’amélioration de nous-mêmes.

Et aussi avec la confiance que ça pourrait aussi avoir un effet sur les relations avec les autres. Celle-ci est l’éducation que l’artiste souhaite et qui pourrait devenir en effet la clé du changement.
“Créer sa liberté,
dire un NON sacré même face au devoir….
Prendre le droit à de nouvelles valeurs
est la chose la plus terrible qui soit…”
F. Nietzsche, “Ainsi parlait Zarathoustra”
dire un NON sacré même face au devoir….
Prendre le droit à de nouvelles valeurs
est la chose la plus terrible qui soit…”
F. Nietzsche, “Ainsi parlait Zarathoustra”
Un chaleureux merci à Thierry Mabille pour la révision de la traduction française.
